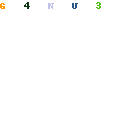En juin, Rio va vibrer aux couleurs du football : depuis deux ans déjà la ville se transforme, nettoie ses bidonvilles, construit des tours et des hôtels, tente de réguler sa circulation. Les Cariocas attendent avec impatience et un peu de crainte l'arrivée des joueurs du monde entier. "C'est très excitant, raconte l'écrivain Ronaldo Wrobel. Et de toute façon, si la ville devient invivable, il nous restera toujours la Costa verde."
En juin, Rio va vibrer aux couleurs du football : depuis deux ans déjà la ville se transforme, nettoie ses bidonvilles, construit des tours et des hôtels, tente de réguler sa circulation. Les Cariocas attendent avec impatience et un peu de crainte l'arrivée des joueurs du monde entier. "C'est très excitant, raconte l'écrivain Ronaldo Wrobel. Et de toute façon, si la ville devient invivable, il nous restera toujours la Costa verde."
La Costa verde. 200 kilomètres de côte, 2 000 plages en bord de forêt, 350 îlots montagneux. Si son joyau le plus connu reste la ville coloniale de Paraty, la longue couronne de criques qui s'étend à l'est de Rio recèle encore beaucoup d'endroits méconnus. C'en est même le principal charme. La Costa verde s'ouvre avec le parc national de la Tijuca.
On y marche, cherchant les oiseaux dont les cris vous font lever la tête, sous la frondaison d'arbres gigantesques, avec de temps en temps une échappée vers la mer qui, plus bas, envoie ses paquets de vagues à l'assaut des falaises. Un luxuriant décor pour cette Mata Atlantica, une des forêts les plus menacées du monde. Labourée, abattue, surexploitée par la canne à sucre, le café, le bois, elle ne possède désormais que 7% de sa surface initiale. Même si les animaux y vivent encore nombreux, parmi 900 espèces endémiques. Quelques centaines d'indiens Caiçaras y habitent aussi, descendant à la fois des colons portugais, des Noirs africains et des indiens Tupinambas.

Au village de Joatinga, Olimpio, 86 ans, ancien commis voyageur venu ici par amour, raconte une vie de pêche et de cueillette. Il a huit enfants et quatre fois plus de petits-enfants. Beaucoup sont partis, tentés par la grande ville. Certains s'y sont perdus, pris au piège de la drogue et de la violence. Sa petite-fille Alessandra, elle, essaie aujourd'hui de faire vivre par le tourisme cet endroit que l'on atteint en pirogue, seulement à marée haute.
Un peu plus loin, voici Punta Negra, où l'accueillant Tetelco a ouvert quelques modestes bungalows. On arrive dans cet endroit magique soit par une mer souvent houleuse, soit après une marche de plusieurs heures. La récompense est là : une petite crique battue par la mer, une gargote en bois où déguster une caïpirinha, des barques couchées le ventre en l'air, des gamins courant sur la plage et disputant une partie de foot. Authentique, simple, paisible. Comme se lever tôt le matin pour accompagner les pêcheurs poser leurs grandes nasses à l'entrée de la baie...

Si l'on continue cette somptueuse route côtière, voilà bientôt Praia Sono, étendue de sable blanc considérée comme l'une des plus belles plages du monde, avant de débarquer au Saco do Mamangua, appelé aussi "le ford brésilien". L'eau s'y enfonce sur 8 kilomètres à l'intérieur des terres, où vivent une centaine de familles caiçaras. Un très joli lodge accueille ceux qui se donnent la peine de venir jusqu'ici, puisque nulle route n'y accède à part un bateau-navette. Face à lui, deux "pains de sucre" se dressent, petits frères du célèbre rocher carioca.
La forêt abrite aussi une faune que l'on peut guetter, allongé au bord de ce bras de mer particulier : aigrettes, martins-pêcheurs, ibis et autres oiseaux le disputent aux crabes et loups de mer qui se retrouveront directement dans votre assiette. Au bout d'une semaine, le retour à la civilisation se fait sur l'île d'Ilha Grande, devenue depuis quelques années l'un des spots préférés des habitants de Rio. Une île au destin pour le moins contrasté. Ancien repaire de pirates, puis léproserie, elle a également abrité un bagne qui se visite aujourd'hui, non loin dela plage sauvage de Dois Rios.

C'est là que l'on peut rencontrer Julio, le dernier des bagnards qui, après vingt ans de détention, n'a pas voulu quitter les lieux et y vit encore. Un pittoresque personnage qui vous raconte avec un très net relativisme moral sa vie et ses incartades qui, si on le comprend bien, sont allées jusqu'au meurtre.
Aujourd'hui, Ilha Grande demeure avant tout une réserve naturelle très protégée : forêt envoûtante, plages somptueuses, bungalows et pousadas charmantes, le tout dominé par la crête du pic du perroquet, 982 mètres que l'on gravit lorsque le brouillard n'en embrasse pas le haut. Il n'en faut pas plus pour s'extraire un moment de la folie des stades.
Par Hubert Prolongeau
Nouvel Observateur